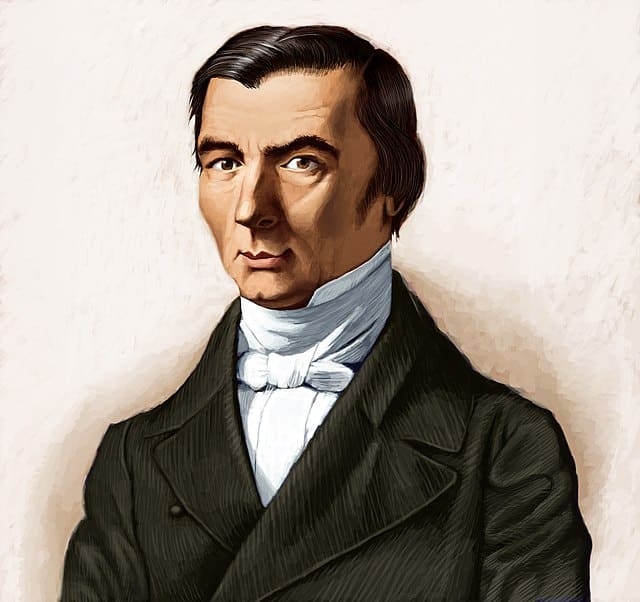Frédéric Bastiat, figure incontournable de la pensée économique libérale au XIXe siècle, est particulièrement célèbre pour sa Pétition des marchands de chandelles.
Ce texte satirique illustre avec une ironie mordante les absurdités inhérentes aux politiques protectionnistes, en feignant de réclamer la protection des fabricants de chandelles contre un concurrent omniprésent et gratuit : le soleil.
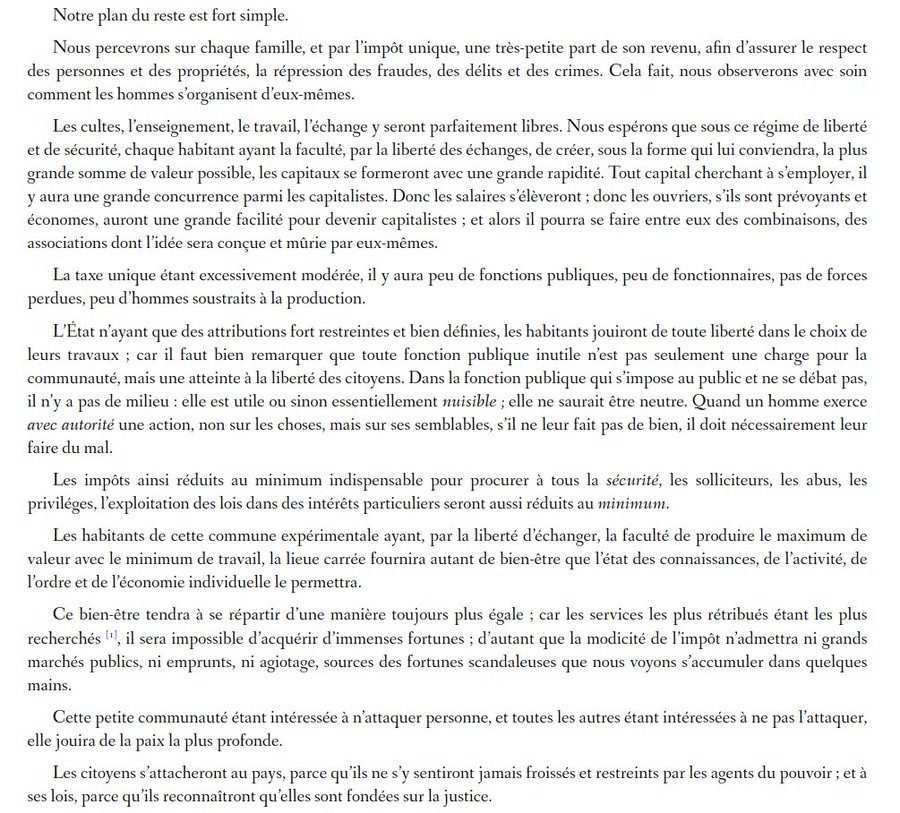
Par cette démonstration par l’absurde, Bastiat démontre que les barrières commerciales, loin de protéger l’économie nationale, entravent l’innovation, nuisent au consommateur et appauvrissent la société dans son ensemble (Bastiat, 1845).
La critique de Bastiat repose sur une compréhension intuitive des mécanismes de l’échange et de la valeur. En affirmant que les restrictions au commerce sont instaurées au bénéfice d’intérêts particuliers et au détriment de l’intérêt général, il s’inscrit dans une tradition libérale remontant à Adam Smith et poursuivie par des penseurs comme David Ricardo (Irwin, 1996). Hayek (1991) souligne d’ailleurs que Bastiat, bien que parfois perçu comme un vulgarisateur, a su exposer avec clarté et rigueur les principes économiques complexes, notamment en ce qui concerne les avantages comparatifs et la concurrence.
Le raisonnement de Bastiat s’ancre également dans une critique plus large du rôle de l’État.
Selon lui, lorsque celui-ci intervient pour protéger certaines industries, il fausse le libre fonctionnement du marché et entrave la dynamique de la concurrence (Salin, 1996). Cette approche est en phase avec les principes de l’école autrichienne d’économie, pour laquelle l’interventionnisme étatique conduit inévitablement à une mauvaise allocation des ressources (Rothbard, 1995).
Les implications de la pensée de Bastiat demeurent pertinentes dans le contexte contemporain.
Comme le souligne O’Rourke et Williamson (1999), les débats actuels sur le protectionnisme et le libre-échange trouvent un écho direct dans les arguments avancés par Bastiat au XIXe siècle. En effet, ses critiques mettent en garde contre les effets pervers de politiques qui, sous couvert de protéger des emplois, réduisent en réalité la compétitivité globale et freinent la croissance économique.
Ce lien avec le réseau est crucial, car il permet au consommateur de continuer à bénéficier d’une alimentation en électricité de manière continue.
Cependant, la question se pose sur l’opportunité de cette taxe si le consommateur utilise des batteries de stockage.
Dans ce cas, l’individu peut théoriquement se passer du réseau pour une grande partie de ses besoins énergétiques, notamment pendant la nuit ou lors de périodes où l’ensoleillement est faible.
L’objet de la taxe pourrait alors être de financer l’entretien et la gestion du réseau, en particulier pour compenser les coûts liés à la fourniture d’électricité aux consommateurs pendant les périodes où leur production solaire n’est pas suffisante.
En d’autres termes, même si un consommateur utilise des batteries pour stocker l’énergie excédentaire produite durant la journée, il reste dépendant du réseau en cas de besoin, ce qui justifie une taxe visant à soutenir ce service de « secours » du réseau.
Toutefois, si le consommateur est totalement autonome grâce à ses panneaux et ses batteries et ne se connecte plus au réseau, la logique de cette taxe devient plus floue.
Dans ce cas, la question se pose de savoir si cette taxe devrait toujours s’appliquer, puisqu’il ne sollicite plus les infrastructures du réseau national.
En revanche, si la taxe est conçue pour répondre à un besoin de financement lié à l’infrastructure collective (les lignes de transmission, la gestion du réseau, etc.), elle pourrait ne pas être modifiable en fonction du niveau d’autoconsommation d’un utilisateur.
Cela soulève aussi des questions sur l’équité : le consommateur autonome pourrait se voir taxé de manière injuste s’il ne consomme plus d’énergie du réseau, mais continue à participer financièrement à son entretien par cette taxe. À contrario, si la taxe vise à encourager certains comportements (comme l’autoconsommation ou la participation à des mécanismes de flexibilité réseau), la question du type de consommateurs visés par cette taxe pourrait également être redéfinie.
Il est également possible que la taxe vise à compenser d’autres impacts externes du système énergétique, comme l’impact environnemental des ressources fossiles ou la gestion des excédents d’énergie sur le réseau.
Une analyse plus approfondie de l’objectif et de la structure de cette taxe pourrait clarifier davantage son intention et son application envers différents types de consommateurs.
Références Bibliographiques :
- Bastiat, F. (1845). Sophismes économiques. Paris : Guillaumin.
- Hayek, F.A. (1991). The Trend of Economic Thinking: Essays on Political Economists and Economic History. Chicago: University of Chicago Press.
- Irwin, D.A. (1996). Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade. Princeton: Princeton University Press.
- Rothbard, M.N. (1995). An Austrian Perspective on the History of Economic Thought: Classical Economics. Cheltenham: Edward Elgar.
- Salin, P. (1996). Libéralisme. Paris: Presses Universitaires de France.
- O’Rourke, K.H. & Williamson, J.G. (1999). Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy. Cambridge, MA: MIT Press.
KeyWoRDS :
- Trading court terme (électricité, gaz, CO₂)
- Analyse de marché & prévisions (spot, interconnexions, capacités)
- Statistiques appliquées à la modélisation des besoins physiques
- Optimisation opérationnelle & gestion du portefeuille
- Gestion active de la courbe de charge (valorisation de la flexibilité)
- Négociation de contrats d’achat long terme
- Back-office trading (confirmation, P&L, capture des deals)
- Expertise multi-énergies (gaz, pétrole, électricité)
- Arbitrage du risque prix dans des contextes de forte volatilité
- Opérations d’achat et de vente sur les marchés de gros français et allemands
- Analyse des fondamentaux du marché (production, interconnexions, CO₂)
- Modélisation statistique des besoins physiques
- Étude et optimisation des grilles tarifaires (transport/acheminement)
Finis rerum.
Direction des Études Économiques.
Copyright © 2025 SYNERGYGROUP. All rights reserved.
Par Alexis Vessat, docteur en économie de l’énergie, expert en systèmes énergétiques européens.